Passée la folle nuit de traversée des hautes vallées d’Anatolie centrale, le jour se lève sur de vastes espaces d’altitude faiblement enneigés qui n’offrent désormais que de très rares signes perceptibles de civilisation. En matière de panoramas vierges et sauvages, le rail a un net avantage sur la route, laquelle circule la plupart du temps en paysages plus domestiqués pour relier les points de peuplement, et traverse régulièrement agglomération et villages, même les plus modestes. Dans ces contrées accidentées, le tracé ferroviaire au contraire ne relie que les principales villes, très distantes les unes des autres; parfois même, il les évite carrément, quand sa trajectoire est astreinte en priorité par les contraintes du relief. On ne peut oublier aussi que notre ligne, tracée à l’origine par des ingénieurs militaires prussiens, puis britanniques à travers l’empire Ottoman, avait avant tout la visée stratégique de relier Constantinople à Bagdad, et non de favoriser les dessertes locales et l’épanouissement économique des communautés humaines traversées…
Sur notre trajet, en s’enfonçant en plein territoire Kurde, même les poteaux télégraphiques qui jalonnaient fidèlement la voie jusqu’ici semblent avoir disparu sur de longues sections du parcours, laissant penser que la pénurie de combustible de ces contrées déshéritées et sans la moindre forêt explique peut-être leur absence. Pourtant, en dépit d’une réelle sauvagerie des paysages – forcément romanesque – dès que notre convoi stoppe en pleine voie, on est surpris de voir surgir du néant alentour en direction du train, et sans grand délai, bergers revêtus de leurs raides pelisses bouclées ou quelques femmes emmitouflées colportant leurs produits locaux. Immanquablement, au troisième jour de sa perte complète de repères, le passager occidental du train qui vit pour la première fois ce type de contact s’imagine alors facilement dans un western; la vision de ces visages jeunes, mais parcheminés par le froid, des interjections gutturales qui résonnent jusqu’aux montagnes proches et de ces costumes sortis de la nuit des temps: à coup sûr, autrefois à bord du Southern Pacific, la première rencontre avec les tribus indiennes des confins du Dakota devait avoir quelque chose de commun avec cela !
Très curieusement, passé le premier instant de surprise, ces rencontres imprévues et presque irréelles à mes yeux ne m’inspirent aucun sentiment d’exotisme, mais d’abord une sorte de malaise qui ne me quittera jamais par la suite, à chaque fois que je serai confronté dans mes incessants voyages, et même à domicile, à la sollicitation si ambiguë des pauvres saisissant l’opportunité du passage éphémère de quelques nantis… Au-delà, ce qui est insoupçonnable pour le néophyte que je suis alors, c’est que je vis là ma première rencontre fugace avec d’authentiques nomades, qui ne sont en fait pas des Kurdes, mais l’une des multiples minorités de souche originelle turco-mongole qui parcourent encore à l’époque cette vaste région montagneuse de l’est anatolien, carrefour millénaire de tous les grands empires de l’Histoire: ceux d’Alexandre, de Kubilaï Khan ou de Soliman le Magnifique… L’étrangeté de cette première rencontre, et les sentiments confus qu’elle remue en moi, sans que je sois alors capable de les décrypter, tient au fait que je vis alors – sans le soupçonner sur le moment – l’acmé de mon voyage initiatique vers l’Orient. En effet, il me faudra encore de longues décennies pour élucider peu à peu les origines de ma lignée maternelle, et les authentifier: mes lointains ancêtres de ce côté, probablement Kazakhs ou Tatars, sont bien issus des steppes d’Asie Centrale; d’ailleurs, l’unique portrait photographique que je détiens – par miracle – de mon arrière grand’mère montre un visage qui pourrait être autant Mongol qu’Inuit… Assurément, et sans que cela s’explique sur l’instant, en cette fin décembre de 1972, ceux qui surgissent de nulle part, poussant parfois de maigres troupeaux entre les plaques de neige, et se présentent aux fenêtres de mon wagon sont donc mes très lointains cousins. Il ne m’est pas nécessaire d’avoir décodé aussi clairement tout cela à l’époque pour percevoir confusément que mon intronisation à l’Asie, loin d’être un saut vers l’inconnu, paraît au contraire me replonger dans le bain quasi amniotique de mes origines génétiques, et même culturelles, au sens premier. À ce stade de ce voyage initiatique, et sans pouvoir le rationaliser le moins du monde, je me sens en familiarité instinctive et naturelle avec un milieu qui devrait m’apparaître totalement étranger. Quelques mois plus tard, après une immersion quotidienne et continue dans le quotidien d’un Orient qui m’a absorbé sans peine, je commencerai à entrevoir – par contraste inverse – pourquoi j’ai ressenti depuis toujours un certain inconfort culturel et mental dans ma propre patrie occidentale de naissance.
À cette période-là, ce que j’ignore encore, c’est que ces tribus nomades ne devraient plus être encore là, à 2500 m d’altitude et plus au plein cœur de l’hiver anatolien. Depuis toujours, ces hauts plateaux ont seulement été les quartiers d’estive de leurs troupeaux; dès l’automne, ils descendaient auparavant vers la Mésopotamie pour y trouver des hivernages plus cléments et assurer le pâturage de leurs troupeaux. Depuis les années soixante, les dictatures de la région ont dissuadé, puis interdit leurs migrations et les ont rendus prisonniers de leurs hautes montagnes; pas étonnant que leurs troupes décimées viennent mendier aux fenêtres de ce train venu d’une autre planète… L’année suivante en Iran, nanti d’un laisser-passer très exceptionnel, j’ai pu pénétrer les réserves interdites à toute visite où le régime iranien d’alors tentait de sédentariser de force certaines de ses insaisissables populations nomades; j’ai alors commencé à comprendre que les traditionnels mouvements saisonniers de migrations de ces minorités perpétuellement itinérantes étaient empêchés, non seulement là, mais sur tout le Moyen Orient. Les cultures millénaires qui avaient parcouru et fécondé l’immense espace entre les sources du Tigre et le delta de l’Indus étaient en voie d’assimilation ou d’éradication définitive. L’Orient du XXème siècle a eu aussi ses Peaux-Rouges, et leur a infligé des recettes ethnocidaires éprouvées depuis un siècle outre-Atlantique…
Dans ces régions orientales de l’Anatolie, en l’absence de toute agglomération sur notre trajet, et donc de toute gare d’étape sur des centaines de kilomètres, les occasions d’apercevoir leurs habitants sédentaires sont pratiquement inexistantes. Pourtant les arrêts à répétition et en pleine nature de notre train ne manquent pas; ils sont plus rarement que la nuit précédente imputables à l’obligation de céder la voie unique à un convoi circulant en sens inverse; le plus souvent ce sont d’autres causes multiples qui les provoquent; elles nous sont rarement justifiées, et c’est en vain que l’on tente d’en saisir les clefs auprès de nos accompagnants. Même si les patrouilles militaires qu’on peut apercevoir sporadiquement au loin, et même l’escouade armée qui finira par embarquer à bord du train pour l’escorter au-delà de ces territoires à large majorité Kurde laissent peu de doute sur l’incertitude du parcours dans ces régions.
Il faudrait être d’une grande naïveté ou parfaitement inconscient des conflits ethniques qui sont consubstantiels à la longue histoire de l’Orient pour ignorer les tensions bien réelles qui ont différé notre départ d’Istanbul et qui perturbent maintenant la marche régulière de notre convoi. Toutefois, cette situation ne semble pas générer d’inquiétude particulière parmi les passagers occidentaux que nous côtoyons. Les vertus presque magiques du train au long cours agissent indiscutablement sur eux comme un lénifiant, et il ne règne à bord pas la moindre angoisse palpable – du moins en apparence; tout juste une légère attente plutôt curieuse de l’imprévu qui pourrait survenir à tout moment. En résumé, l’ambiance n’est quand même pas comparable à ce que l’on peut imaginer de l’insouciance supposée des passagers du Titanic, tout accaparés à leurs festivités nocturnes sur une mer d’huile, alors que leur navire fonçait à plein régime vers le fatal iceberg. Bien au contraire, à chaque arrêt intempestif du Vangolü Express au milieu de nulle part, nombre de curieux vont aux fenêtres du train, guettant vers le lointain les rebelles – supputés Kurdes par la rumeur – qui pourraient tenter de nous barrer la route, et peut être même nous prendre en otages. Au grand dam de l’équipage turc du train, la sympathie des passagers baba-cool européens et anglo-saxons va, à l’évidence, à la cause des rebelles, et nul ne suggère qu’on devrait pousser à fond la vapeur de nos deux motrices pour fuir en force cette zone d’insécurité et gagner au plus vite un refuge ‘civilisé’.
L’angélisme ambiant dans le ghetto occidental du train ne dit rien de ce que vivent les passagers turcs et iraniens logés dans la section avant, au-delà des wagons-restaurants… D’ailleurs, ceux-ci ont exceptionnellement mis leurs fourneaux en veille et suspendu le service, et les passagers sont dissuadés de circuler à volonté entre les voitures; à chaque ralentissement ou arrêt, il est fermement prohibé de descendre se dégourdir les jambes. Mais ces mesures de précaution sont prises avec calme et bonne humeur, comme si, à bord d’un bateau, on se préparait sans cérémonie à un petit coup de tabac… On découvre là ce qu’une boite de ferraille conçue par l’homme peut avoir de sécurisant dans notre culture, contre toute logique élémentaire, qu’elle glisse sur des rails, loin de tout, à plus de 2500 m d’altitude moyenne, ou surnageant de 6500 m des abysses marines glacées ! Dans les deux cas, c’est la sérénité qui l’emporte chez les passagers, avec la certitude d’arriver à bon port dans un cocon réputé invulnérable. Un demi-siècle plus tard, qui, parmi les plus de quatre milliards de passagers aériens actuels, ne songe pas, juste un quart de seconde avant le décollage, à l’absurdité absolue de prétendre qu’une enclume de 350 tonnes pourrait voler ?
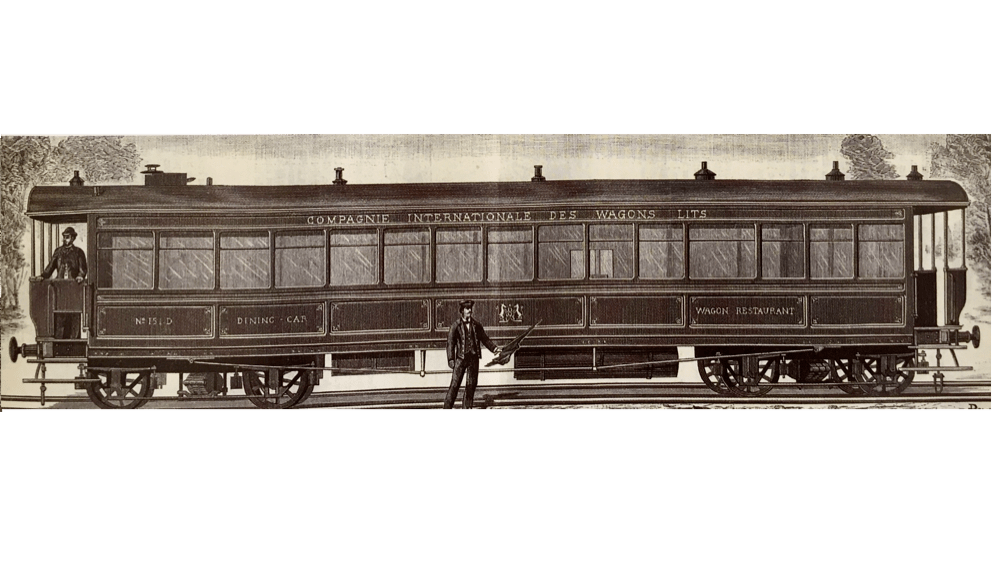
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.