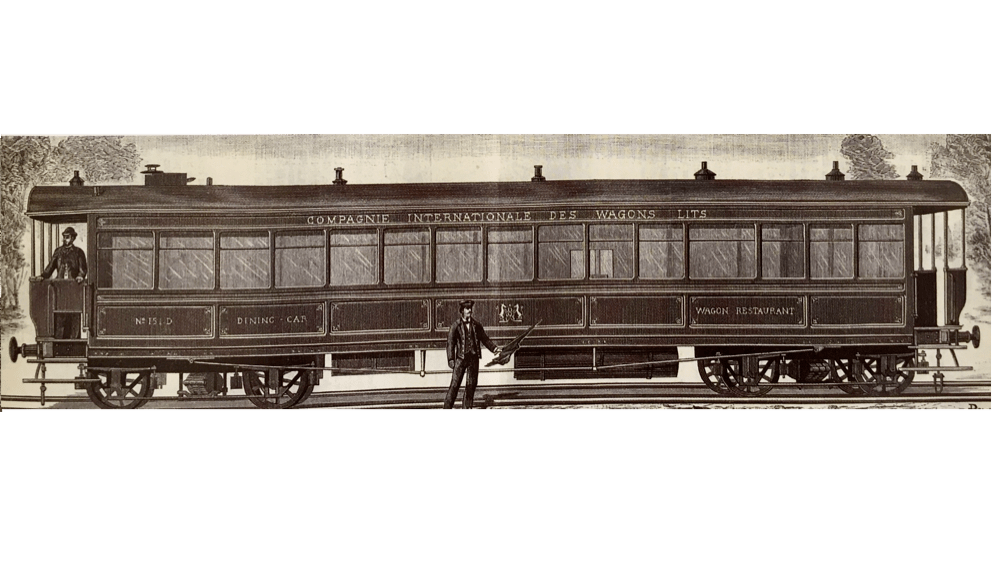L’imprévu d’une correspondance prolongée à Istanbul aurait pu être plus fertile en péripéties et découvertes touristiques si elle n’avait pas été brutalement raccourcie par la pacification prématurée d’une poignée de rebelles opérée à notre insu à 1.500 km plus à l’est… Mais, après tout, la journée et demie d’attente passée sur place m’a amplement suffi pour remplir le contrat prioritaire que je m’étais implicitement fixé au départ. S’agissant d’un parcours conçu comme une sorte d’incubation de l’Orient, j’avais été plutôt bien servi par la suspension temporaire du transit depuis mon monde occidental familier vers l’autre, encore en majeure partie mystérieux pour moi. En raison des circonstances, l’escale improvisée d’Istanbul me préservait de toute tentation de stakhanovisme touristique, ce qui constituait un excellent alibi pour divaguer librement en jouissant simplement d’un entracte de temps suspendu. En instaurant ce temps qui n’autorise que des découvertes improvisées, cette pause enrichirait bien mieux mon début d’initiation à l’exacte interface géographique et culturelle des deux mondes auxquels j’avais de longue date pleine conscience d’être génétiquement affilié [1].
Sans tergiverser sur les incontournables et prioritaires curiosités stambouliotes, figures imposées pour tout touriste respectable, j’ai préféré errer de longues heures le long du Bosphore à suivre le flux incessant des grands navires et rêver en apercevant la rive asiatique, qu’aucun pont ne déflorait encore depuis l’Europe. Plutôt que visiter en détail les salles ornées du palais de Topkapi ou quelque musée édifiant, j’ai donc ‘perdu mon temps’ à vagabonder… Dans ma condition universitaire d’alors, il aurait pourtant été de bon aloi d’impressionner quelques bobines de film argentique pour les futures soirées-diapos à infliger au retour à mon entourage; certes, j’ai concédé sans réticences à une immersion dans Sainte-Sophie, ou à déambuler au Grand Bazar ou dans quelques autres lieux emblématiques de l’antique Byzance; mais c’était seulement pour tenter de m’y imprégner pleinement de la fusion symbolique des deux mondes, l’occidental et l’oriental.
À ce propos, il faut bien reconnaître ici le rapport plutôt paradoxal que j’ai toujours entretenu avec la visite de lieux touristiques. De l’enfance, j’ai en effet hérité de parents très friands en la matière une pratique exigeante et bien tempérée d’un tourisme réputé culturel: dans sa version traditionnelle, c’est celui qui impose la consommation intense et assez exclusive des moindres fragments de patrimoine historique et artistique. Pour chaque lieu sélectionné par mes parents comme destination de loisirs, témoins architecturaux et collections de musées étaient donc des figures imposées de mon éducation permanente. Le préjugé parental y voyait les vecteurs didactiques privilégiés et les décodeurs quasi exclusifs d’une réalité que j’ai tôt fait de juger quelque peu embaumée… Pas de quoi non plus vraiment s’apitoyer sur mon enfance persécutée par un abus de dressage culturel… Mais, après m’être subrepticement soustrait à ces contraintes dès l’adolescence, j’ai très vite cherché à développer par moi-même des formes plus intuitives d’approche des lieux de passage – par forcément étoilés par les guides – où je me trouvais, souvent au hasard de mes précoces errances solitaires. J’y ai forgé à l’instinct ma propre pratique d’un tourisme culturel plus instinctif, sensuel en quelque sorte. Bien sûr, la quête de l’Histoire des sites, comme du vécu quotidien de ceux qui les ont peuplé, de leur personnalité et même de leurs sens cachés sont devenus la priorité essentielle; mais aussi la vibration immanente des lieux, qui communique leur densité ; et également ce que l’on pourrait résumer comme leur anatomie intime, leurs matières et leur forme. Dès lors, j’ai été conduit à fomenter une curiosité archéologique plutôt non-conventionnelle où la quête de l’esprit des lieux devait primer de plus en plus sur une intelligence plus objectivable, seulement fondée sur leur apparence ou leur prestige matériel.
Jeune adulte, totalement indépendant depuis des années déjà, débarquant au débotté et pour la première fois à Istanbul, j’entends donc laisser libre cours à mon instinct de découverte avec préjugés, mais sans conventions. C’est pourquoi je passe tant d’heures à simplement errer et contempler les panoramas, à observer le ballet ordinaire de la rue plutôt que de visiter dans l’urgence musées et monuments ‘qu’il faudrait voir absolument’. Tant pis pour ces derniers, je suis d’abord subjugué par la métropole plutôt foutraque qui m’entoure, le rythme de ses habitants et le site naturel qui lui sert de cadre. À ce sujet, sans discussion possible, Istanbul porte bien jusqu’à la perfection le génie topographique réservé au cercle très restreint des grands sites d’exception dans le monde. Pour ceux-là seulement, la coïncidence de leur configuration naturelle et de l’esprit des lieux qui les hante touche à la perfection, et ne doit rien au hasard. De toute éternité, les hommes ont privilégié de tels sites comme leurs repères géodésiques majeurs. Pour la densité métaphysique, cela n’échappe pas à la plupart des visiteurs du Mont Saint Michel ou d’Ayers Rock, au cœur du bush australien. Mais pour la confrontation et le brassage de civilisations, rien n’égale les sites de Hong-Kong, Venise, New-York… et naturellement d’Istanbul. Dans un tel registre, son emprise urbaine et maritime a ceci de supérieurement ‘magnétique’ qu’il tangente, de part et d’autre d’un isthme tranché par le Bosphore, deux gigantesques continents porteurs de la dialectique de leurs univers multi-millénaires respectifs. Impossible d’oublier non plus que le Bosphore matérialise au réel la fracture tellurique par laquelle la Mer Noire, gonflée par le Déluge biblique a sans doute fini par se déverser dans la Méditerranée [2]. Ainsi, le génie topographique du site de la seconde Rome c’est d’être – à mon sens du moins – la parfaite transposition métaphorique de l’icônique contact divin génialement représenté par Michel-Ange au plafond de la Chapelle Sixtine: deux index tendus l’un vers l’autre, à presque se toucher, l’instinct de chaque observateur lui donnant à ressentir l’électrique tension née de ce geste hautement allégorique.
Imaginons un instant que New York et Brest soient face-à-face à portée de vue directe, deux parties d’une même métropole seulement séparées par un détroit de l’Atlantique de quelques centaines de mètres de large, à peine. Ce serait la confrontation directe de l’Ancien et du Nouveau Monde… Eh bien, à Istanbul, deux péninsules s’avancent réellement l’une vers l’autre, presque à se toucher, comme les ultimes appendices des deux énormes masses continentales qui ont porté l’essentiel de la destinée de l’Humanité depuis l’arrivée dans cette même région de nos ancêtres venus d’Afrique. Sauf à être totalement dépourvu de sensibilité – ou de la culture générale la plus élémentaire – on n’échappe pas à l’emprise magnétique d’un tel site. Aucun port de Méditerranée orientale n’égale cette puissance évocatrice du frôlement à la fois symbolique et tectonique de deux mondes. Istanbul est donc bien la Porte d’Orient à privilégier absolument pour qui veut franchir d’un pas le seuil initiatique vers l’Asie Mineure et les immensités qui lui font suite jusqu’aux rives du Pacifique.
———————— ( À SUIVRE —- 11. un départ mouvementé —— ) —————————–
[1] Les racines européenne, celtes et germaniques que m’a transmises mon père, et les souches asiatiques nomades héritées de la lignée russe et mongolo-khazake de ma mère.
[2] Phénomène cataclysmique longtemps cantonné à la mythologie, mais que de récentes études géologiques russes tendent désormais à accréditer comme une probabilité historique plausible